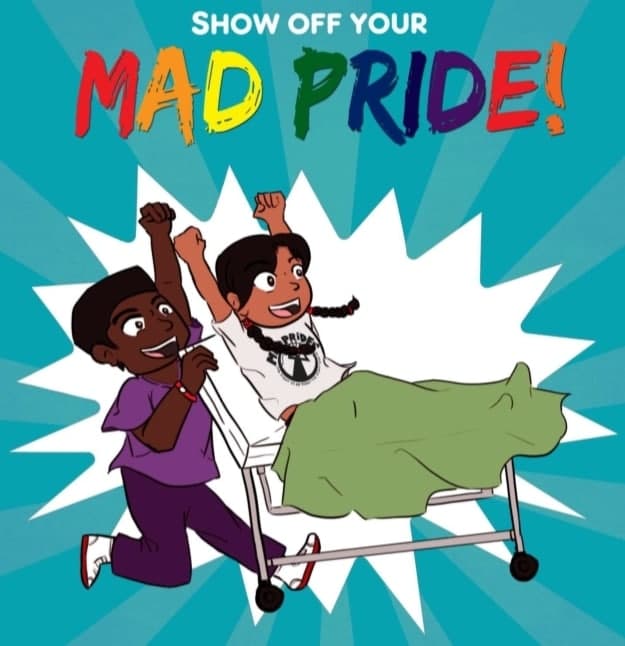J’aurai 27 ans cette année. Quand j’en avais 20, je m’étais promis de ne jamais travailler. Un tabou. Une honte. Comment ça, ne pas travailler ? Et vivre aux crochets de la société ? Quand les autres travaillent durs pour que tu puisses te dorer le cuir, les doigts de pieds en éventail ?
Je suis l’autre chômeur. Celui dont parlent les médias, celui qui ne travaille pas, qui ne travaillera jamais, et qui vous coûte de l’argent (disent-ils).
Je suis celui qui a tellement peur du travail qu’il préfère la honte et l’isolement. Quel profiteur.
J’ai 19 ans. J’ai très peur du monde qui m’entoure et je me réfugie dans les livres et les bières brunes. Après des études secondaires chaotiques, j’entre à l’université pour étudier la philosophie. C’est papa-maman qui payent. A bien des égards, je suis l’un des meilleurs élèves.
J’étudie la philosophie par moi-même depuis mes 16 ans, je comprends vite, j’ai des orgasmes intellectuels rien qu’à lire Foucault, Descartes, Platon. Bref, ça roule. Mon premier examen de janvier arrive. 7/20. Je me revois trembler devant le professeur, tout confondre, les murs s’écrouler, la bile me remonter dans la bouche, et puis ce vieux type ricaner devant mes phrases qui ne font plus aucun sens. L’examen suivant, un examen écrit, je ne parviens plus à passer le pas de la porte. Je fume clope sur clope (des roulées, intello de gauche oblige) devant la façade en piétinant, avant de faire demi-tour. Sur le chemin, je croise le professeur qui me regarde d’un air déçu. Tant pis.
Les années suivantes passent à réessayer d’autres premières, dans d’autres domaines, sans y croire, sans même réellement essayer. Papa-maman veulent que je continue, que je ne reste pas sans rien faire, il faut que je fasse des études, alors ils payent, ils payent. En tout, j’en aurai fait quatre. Pendant ce temps là, je deviens insomniaque, je bois. Je me retrouve à l’hôpital psychiatrique, sans grand effet.
J’abandonne, j’abandonne pour de bon. J’ai 23 ans, je m’inscris au chômage (en Belgique, on peut avoir les indemnités sans avoir travaillé si on a moins de 25 ans). Je lis, je bois, je vois des films, je voyage, je fais semblant d’en profiter. Je pense vaguement à me suicider le jour où mes indemnités prennent fin. Tout ce que je sais, c’est que je ne veux pas travailler. Je deviens un chômeur professionnel – car, oui, échapper aux contrôles administratifs, connaître la législation sur le bout des doigts, c’est pratiquement un job. Un rôle social aussi. J’incarne le parasite. Je vis chez mes parents et je bois 400 euros d’indemnités par mois. Je lis Tolstoï et je me rêve aristocrate.
Un jour pourtant, un sursaut. 25 ans. Mon intérêt croissant pour l’agriculture biologique me pousse à faire une formation en Angleterre, dans le Yorkshire. Les Moors conviennent à mes fantasmes d’aristocrate. J’aime le métier, je hais le travail – et les gens. L’enfer restera toujours les autres. Je tiens quatre mois, je reviens avec une déchirure musculaire et une honte supplémentaire. La fin des indemnités approchent et je n’ai toujours rien.
De temps en temps, je cherche un emploi. Lire les annonces me tétanise. Ce monde me fait peur, très peur. Tous les postes me semblent déshumanisants. Quand on travaille, on vend son temps et son corps. On ne se possède plus en propre. Pour vivre décemment, il faut faire cela pendant 40 heures par semaines, 11 mois sur 12, pendant 45 ans. A chaque fois que je m’approche du travail, je me sens en danger de mort imminente.
Puis, un jour, un sursaut. J’ai 25 ans et au contact de personnes face à qui je me fais honte, je décide de réessayer. Je sais que je fonctionne mieux à l’étranger, alors je dépose mon CV sur un site de recrutement européen. Je suis bilingue français-anglais, et j’ai des connaissances de base en informatique (en tous cas je le prétends) – c’est à peu près tout. Je suis contacté sur la même semaine par Microsoft et Apple. Je prends Apple, ils payaient mieux. Après un processus de recrutement aussi anxiogène qu’intrusif (coucou « Safe Harbor »), je me retrouve à Cork, en Irlande, avec vol et hébergement offert par l’employeur. Mon travail : répondre au téléphone et aider les clients avec leurs problèmes techniques sur leurs appareils mobiles. L’angoisse n’est pas venue tout de suite.
J’aimais bien travailler au début, parce qu’il n’y avait pas encore de pression managériale, j’aimais bien aider les gens, chercher la solution à un problème, et puis la vie était confortable. Les problèmes ont commencé à apparaître quand on a commencé à parler de statistiques, d’objectifs et de compétition par équipes. J’ai cramé en trois semaines. Un jour, après la pause de midi, je me suis rassis devant mon écran, et je ne pouvais plus bouger. Plus rien, fini. Je suis resté bloqué une demi-heure comme ça (une éternité dans un call-center), jusqu’à ce que la collègue à côté de moi me secoue. Quelques semaines d’arrêt maladie payés une misère, et je suis parti. Une amie au téléphone m’a aidé à ne pas me tuer avant de m’inviter chez elle.
Après trois mois de convalescence, je suis revenu en Belgique. Je n’avais plus droit aux indemnités de chômage, alors j’ai directement cherché un travail. Je suis tombé dans un call-center, évidemment. Un truc un peu pareil, pour une entreprise de télécommunications locale : service technique. Passer la porte de l’entreprise était « trigger ». Je rentrais en crise d’angoisse dès 8 heures du matin. Je me calmais relativement, au valium.
Cette entreprise recrute des Shadoks. Il n’y a pas d’autres mots. C’est un ancien service publique privatisé il y a quelques années. L’essentiel de son activité consiste à être en compétition avec un autre ancien service publique privatisé, et cette compétition forme l’essentiel des ennuis rencontrés par l’entreprise. On est passé d’un service efficace et populaire à une usine à gaz sans âme ni sens, qui n’embauche que des intérimaires à la semaine et des CDD, pour essayer de vendre des « bouquets » de chaînes aux clients de l’ancien service public concurrent.
Je revois encore très bien un manager expliquer à son équipe qu’ils n’ont pas refourgué assez de camelote aux clients ce mois ci. Qu’il leur fait comprendre qu’ils sont payés et que si le travail n’était pas fait ils allaient être virés. Ils sont en intérim depuis une éternité, ils viennent là parce qu’ils n’ont pas trouvé mieux et qu’ils n’ont pas le choix et on leur explique ça dès le matin. Bonne journée les larbins.
C’est un des trucs qui m’a toujours semblé le plus intolérable, un truc qui m’empêche encore de dormir la nuit, qui me révolte : que le revenu dépende de son travail. La plupart des gens me disent que je suis un utopiste, un fainéant qui se cherche des excuses, mais cette pensée m’horrifie. Comment est ce qu’on peut travailler correctement quand on sait que chaque erreur peut mener à la perte de son revenu ? Cela me dépasse. J’ai eu le luxe de pouvoir m’en protéger, mais acculé à ce truc, je ne parviens toujours pas à m’y faire. Je préfère vivre dans la difficulté que de vivre dans la peur.
Autre chose, aussi. Ces gens qui vous donnent des sourires mais ne vous considèrent que comme des machines. Cette froideur de l’injonction, l’implacable inhumanité de la domination économique. Comment peut on faire pour vivre avec ? Seulement quand on n’a pas le choix, j’imagine.
Un jour, je me suis levé un peu en retard, à cause de mes insomnies. Pas très en retard, juste assez pour rater mon bus. J’attendais ma correspondance sur une petite place du centre-ville. Je crois que c’est d’imaginer devoir m’excuser d’être en retard à ces raclures qui m’a bloqué. J’ai regardé mon bus passer devant moi, je n’arrivais pas à me lever. Comme dans l’autre travail, je me suis retrouvé paralysé. Quand j’ai pu me relever, j’ai pris le bus en face pour aller boire un café et j’ai écrit un e-mail de démission en chemin. L’agence d’intérim m’a appelé en catastrophe. Ces larbins attendaient des excuses et me grondaient comme un enfant, comme s’ils m’avaient pris la main dans le sac en train de faire quelque chose de mal, alors que mon angoisse venait de me sauver de la démence. Rupture de contrat ? Ce pilier de la civilisation ? Honte sur toi !
J’ai pris une voix minaudante et je leur ai dit que je comprenais bien la complexité de la situation et que c’était pour eux que ça m’embêtait le plus.
Comme j’étais de retour chez mes parents, j’y suis resté. C’était en février, nous sommes en juillet et je n’ai pas retravaillé depuis. Je vis à leurs crochets, je mange, je bois et je fume leur argent, en bon enfant indigne, en ultime parasite qui, selon la logique ultralibérale, n’a pas le droit de manger, boire et fumer, puisqu’il ne travaille pas. Je vais probablement faire les démarches pour demander les aides sociales (type RSA) pour ne pas être un poids pour mes parents. J’ai évoqué une reprise d’études, parce que ça me permettrait de ne pas travailler jusqu’à mes 30 ans. J’aime les études auxquelles je songe, mais je n’y crois plus. Je ne crois plus en être capable. Je ne crois plus à grand chose, d’ailleurs. Régulièrement, j’ai envie de me tuer. Je cherche ce qui me retient et je m’y accroche.
Je ne travaille pas, mais ce n’est pas pour ça que je ne fais rien. Je m’informe, j’apprends des langues étrangères, j’essaye de voir mes amis souvent et d’avoir des relations sincères et honnêtes avec tout le monde, j’essaye de mieux comprendre le monde, de donner à qui je rencontre les clés qui m’ont servi à moi, j’enseigne le français sur Skype, je m’occupe du jardin de mes parents, je milite ponctuellement, et j’ai toujours un prochain livre ou un prochain film en ligne de mire. Mais tout cela, ça ne compte pour rien. Tout ce que je fais, tout ce que je suis, au regard du dogme qui régit nos rapports sociaux (le capital, donc), c’est absolument insignifiant.
Ce monde est d’une violence inouïe. Cette violence, je ne comprends pas comment on peut la tolérer dans sa vie, comment on peut tolérer la violence d’une institution, d’un chef, d’une loi, d’un règlement. J’en suis incapable et cela me désespère. J’aimerais bien y arriver, mais dès que je m’y soumets, tout en moi me dit de fuir, comme si j’étais un animal devant un prédateur. La plupart des psychologues et psychiatres rient (parfois littéralement) quand je dit ça. Je ne suis pris au sérieux par pratiquement personne.
Mais j’ai la trouille, tout le temps. Une trouille qui me transperce et qui me tétanise. Et j’aimerais bien qu’un jour, malgré ce monde de dingue, ça compte pour quelque chose quand on me traite de parasite.
J’ai la chance, le privilège, d’encore pouvoir me cacher de la violence du capital. J’ai l’impression que pour beaucoup de monde, cela rend mon désespoir moins valide. Cette pensée m’attriste beaucoup.
Je ne rapporte d’argent à personne, mais j’ai l’outrecuidance de penser que je fais du bien aux gens que je rencontre. Ça devrait, ça doit être assez pour avoir un toit sous sa tête et de manger à sa faim. Promis, j’abuserai pas sur le caviar.