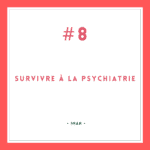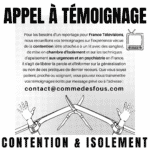HOSPITALISATION PSYCHIATRIQUE [lucie_ptit_lu]

⚠️ TW : isolement, contention, surmédication, suicide, violence se***, décès.
Je témoigne, car avec l’écriture dans mes mains, le silence me rendrait complice.
J’ouvre les portes de l’hôpital psychiatrique sans fiction.
C’est bien loin de l’image que l’on s’en fait dans les films. C’est pire. Ce n’est pas nous qui faisons peur. Ce sont les conditions d’accueil et le quotidien qui sont à dénoncer.
Je raconte mon expérience. Je la sais malheureusement commune.
Je serai d’abord dépossédée du contact avec mes proches. Mon téléphone me sera enlevé.
Je le retrouverai plusieurs jours plus tard.
Avec un SMS de mon compagnon, qui s’excuse de m’avoir internée sous contraintes et qui pleure à chaudes larmes.
Je n’aurais même pas pu le rassurer, par moi-même… Non, il n’aura que les paroles des soignant·es qui l’informeront de si « je suis calme ou non ».
Il vivra sa culpabilité seul. En France n’existe pas encore cet intermédiaire où je serai bien accueillie. Et il le savait…
J’ai eu la chance inouïe qu’un ami s’occupe de lui et lui dise de me ramener des affaires. Il lui a dit d’ajouter surtout un agenda et un stylo. Bien vu.
Puis, je serai dépossédée de mon corps.
Ce seront ces premières sangles qui m’attachaient sur cette table, pieds et poings liés. Justifiées par quoi ? Je m’exprimais en poèmes aux urgences…
Malgré mon état délirant, je savais où j’étais. Je savais que si je me débattais, on m’aurait gardée plus longtemps attachée. J’ai accepté de me faire saucissonner.
Les soignant·es ne m’ont même pas assez sédatée, ni même venu·es me voir si je dormais. Une très grave erreur.
De fait, j’ai déliré pendant plus de douze heures, me tortillant sur ma table.
Entre les histoires que je me racontais et persuadée que j’avais besoin de purger un péché pour être là.
Iels ont une caméra pour surveiller. Iels ont dû bien dormir, ce soir-là, puisque personne n’est venu. Je me souviens de chaque seconde de mes délires, et c’était long, très long. Plus les heures passaient, plus les délires s’aggravaient avec des hallucinations.
Le matin, iels sont venu·es me mettre une couche.
Je ne vous fais pas de dessin. Quand on prive quelqu’un d’aller aux toilettes, c’est comme dans les Sims.
Iels m’ont demandé si je savais qui j’étais.
Je savais qui j’étais, mais j’ai hésité. Je réponds Prophète ou non ? Après une nuit entière à délirer, donc à abîmer mon cerveau, j’étais encore partagée. J’ai donné la mauvaise réponse.
Moi, je voulais juste vapoter. Mes affaires étaient de l’autre côté de la vitre. J’ai juste demandé qu’on me fasse sortir cinq minutes dehors pour que je prenne l’air.
Mais non.
L’isolement, c’est se p*** dessus, être privé·e de contact et d’air, pour une faute que nous n’avons pas commise.
Priver un cerveau de nicotine aussi longtemps, sèchement, c’est aggraver le choc.
Alors je collais mon visage et mes mains contre la vitre qui me séparait de mes affaires.
Je voulais récupérer le collier offert par ma Maman, qui aurait pu me rassurer. Mon pantalon souillé.
Après l’isolement, on m’a mise dans une unité rapprochée. Mais j’ai fait un retour à l’isolement.
Parce que j’ai réussi à sortir me promener.
Je suivais « les signes de Dieu » et pour ce coup-là, il avait assuré, parce que normalement, c’était bien surveillé. Iels ont dit que je m’étais enfuie, alors que j’ai dit que j’étais perdue.
Retour à l’isolement de par l’invalidation de ma parole. Puis retour à l’unité rapprochée.
Et là, iels m’avaient, par contre, trop donné de médicaments. Je n’arrivais plus à parler. Dépossédée de ma parole. J’essayais d’écrire dans le journal apporté par mon copain. Je n’y arrivais pas à cause de la surmédication.
J’avais besoin de noter mes questions, mes besoins, les soignant·es ne me parlaient pas et ne m’expliquaient rien.
J’ai commencé à noter les dates, pour me reconstruire les événements et les souvenirs de ce qui était important. Puis, j’étais juste là, parmi d’autres patient·es, libre de déambuler dans ce petit espace, à moitié délirante.
Aussi, on est dépossédé·e de ce qui nous calme.
J’ai réussi à me faire comprendre d’un autre patient. Lui dire que j’avais besoin de musique pour m’apaiser, et mettre mon morceau en boucle.
On m’offrait des roulées avec grand plaisir, et empathie. Et sans nul doute, de la pitié.
Puis j’ai rencontré celui que j’appelle « mon soleil », et je lui ai demandé s’il faisait partie du personnel tellement il s’occupait bien de nous, de moi.
Non, lui, il était là parce qu’il avait tenté de se suicider.
Comment les soleils peuvent-ils vouloir s’éteindre ?
Je passais mes journées à subir mes traitements trop forts, atroces, avec des dyskinésies au visage.
Ma bouche était tordue, m’empêchant de vapoter correctement. Mon seul plaisir. Il faisait froid, j’avais raté Noël.
Un patient a réussi à m’emmener dans sa chambre. On repassera pour la surveillance, même en « unité protégée ».
Une danse dégueulasse forcée, un baiser forcé.
Écœurée, démunie, sans parole. Comment j’allais le dire à mon copain ? Viens me chercher, y a un mec qui abuse de moi, on m’attache, on m’isole et on me surmédicamente ? Mon compagnon pouvait effectivement pleurer…
J’ai fini par en parler à mon soleil, qui a pu signaler cette brave merde.
Je passais mes journées dehors sur un banc, au soleil, jusque tard le soir, sous la neige de décembre. Il y avait encore un peu de dignité dans ce service, nous n’étions pas beaucoup. Assez pour qu’on se parle toustes, mais pas assez pour qu’un·e soignant·e me parle.
Puis j’ai été libérée dans une unité plus libre.
C’est ça, ouais. J’ai porté pendant trois semaines un pyjama imposé. Je n’ai jamais demandé pourquoi. Je n’avais le droit qu’à une petite cour pour sortir.
Puis s’est ensuivi un mois de dépérissement.
Au départ, j’avais encore l’énergie de la manie pour socialiser. Très vite, le traitement me zombifie. Le psychiatre ne m’écoute pas sur ma santé mentale retrouvée, ni pour mon intolérance aux médicaments.
« Je suis le protocole. » me répétait-il. Le peu de fois où je le voyais. Un protocole médicamenteux, ça s’adapte, non ?
La connaissance de moi et mon récit n’avaient aucune valeur. Dépossédée de ma crédibilité.
Pour me calmer chez moi à ma plus grosse crise maniaque, je ne prenais que la dose minimale du traitement antipsychotique. À l’HP, on m’en donnait dix fois plus + médicaments de sédation…
Alors j’ai commencé à m’enfermer dans ma chambre, à surveiller à ce qu’iels ne repèrent pas que je vapotais à l’intérieur. Je ne voulais parler à personne. Je mangeais à la table des plus abîmé·es parce que j’en faisais partie.
Je ne sortais même plus une minute par jour.
Mon soleil m’offrait des cigarettes, celles que j’aime bien, mentholées. J’attendais impatiemment que mon compagnon vienne me rendre visite tous les deux jours. Il ne m’avait jamais vu pleurer. Sauf cette fois-là, dans ses bras.
Nous ne savions pas quand j’allais sortir.
Nous savions toustes les deux que c’était inutile que de me maintenir dans cet état.
Aucune activité en 1 mois et demi, PAS UNE, n’a été proposée aux patient·es. Nous déambulions entre nous. Et moi je fuyais tout le monde.
Puis, quel intérêt des « permissions »à l’extérieur ?
Mon compagnon récupérait un objet cassé. Je refusais les appels de mes proches. Que leur dire qu’ils pourraient décemment entendre ?
J’avais tellement d’effets secondaires que je ne pouvais pas rester sur le canapé à regarder une série. Je piétinais le sol en faisant des allers-retours toute la journée. J’avais un regard de morte.
Je cachais les sucreries qu’il m’apportait, parce que c’était un peu de sa présence qu’il y avait à travers ces douceurs.
Pas une fois, les soignant·esne sont venu·es me parler en un mois et demi.
Ce fut le plus tragique pour moi. Le manque de lien. Cela demanderait de si grands efforts ?
Je ne tolère aucune excuse institutionnelle.
Je répète : je ne tolère aucune excuse institutionnelle. Encore moins pour celleux qui ont été envoyé·es en réanimation, à cause de traitements trop lourds et inadaptés. Aucune excuse pour celleux qui sont mort·es étouffé·es dans leurs vomis, contentionné·es sur cette table.
Si mon copain n’a pas eu d’autre choix que de m’interner, la psychiatrie, quant à elle, a d’autres choix que de nous traiter ainsi.
Moi vivante, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour trouver une autre manière d’accueillir ces phases maniaques. Par l’écriture pour le moment. Peut-être un jour en tant que pair-aidante…
Pour que la honte change de camp.
MON SOUHAIT : pour que plus jamais une hospitalisation en psychiatrie ne ressemble à ça…
Depuis la chambre sans fenêtre,
De la table où le corps devient objet,
De la nuit qui dure douze heures et ne dort pas.
La main qui attache sans regarder,
Et celle qui détache sans comprendre.
J’ai vu les âmes s’éteindre sous les protocoles,
Et les soleils qui, même blessés, réchauffent encore.
Je dis ceci :
Le soin n’est pas un ordre,
Le calme n’est pas la paix,
La docilité n’est pas la guérison.
Je dis ceci :
Aucun diagnostic ne vaut une main qui écoute.
Aucun médicament ne remplace un regard qui voit.
Aucun protocole ne peut soigner sans amour.
Je dis ceci :
Tant qu’un seul être sera attaché au nom du soin,
je parlerai.
Car moi vivante,
Je témoignerai pour celles et ceux qu’on a rendus muets.
Et je le répéterai jusqu’à l’usure de mes mots :
Si c’est contraint,
Ce n’est pas du soin.
lucie_ptit_lu