La valse des psychiatres [Anne-Claire]

« De l’art et la manière de soigner »
J’ai réussi à cumuler sept psychiatres en un an. Cela fait une belle moyenne d’un tous les deux mois. On pourrait croire que je les use jusqu’à la corde, même pas. Je les collectionne comme je collectionne les pilules. « Tiens, on va commencer par un somnifère. Ah mais ce n’est pas suffisant, rajoutons un hypnotique… Non, toujours pas, il est temps de tenter les antidépresseurs. Mais ce n’est pas encore assez, allez un anxiolytique par-dessus ».
Le premier, je l’ai rencontré aux Urgences d’une petite ville de province. Je n’avais pas encore fait de tentative de suicide. J’avais parlé d’en faire, je ne dormais plus depuis trois jours, mon mari paniqué m’avait amené à l’hôpital. Le psychiatre m’avait écouté d’un air ennuyé avant de me renvoyer chez moi avec cette sentence : « Vous êtes d’un tempérament anxieux, l’arrivée d’un enfant s’accompagne toujours de beaucoup d’angoisses, rentrez chez vous et surmontez-les ». Non, on ne peut pas dire que celui-là m’avait poussé à la consommation de pilules. Par contre, il m’avait laissé encore plus désemparée que je n’étais arrivée. Non, ce n’était pas juste des angoisses passagères que de ne pas dormir DU TOUT pendant trois jours, même en ayant pris des somnifères. Non la crise que je ressentais, je ne pouvais l’affronter toute seule. Alors ma tante psychologue m’avait orienté en urgence vers un deuxième psychiatre.
Le deuxième était un gentil taiseux. Il m’avait écouté quand j’étais en crise, quand j’avais parlé de me foutre en l’air. Une fois, j’avais réussi à le faire rire : « Oh mais vous savez, vous ne devriez pas faire crédit à vos patients suicidaires, je ne vous avais pas payé la dernière fois et si j’avais réussi ma tentative de suicide, vous auriez perdu 80 euros. »
Par contre, quand ça allait bien, ou du moins relativement mieux, je sentais que je l’emmerdais profondément, qu’il était chez lui avec son diner du soir pendant que je tentais de lui faire comprendre les angoisses tapies au fond de moi. D’une fois sur l’autre, il oubliait quels médicaments il m’avait prescrits. Pourtant, je continuais à me rendre bien sagement aux séances, à m’asseoir sur le fauteuil en face de lui, à jeter mon sac à mes pieds et à parler pour meubler le silence. Il y avait bien un divan mais je voulais éviter le cliché. Je n’étais pas encore prête pour cela. Ce n’était que mon deuxième psychiatre, juste un premier orteil trempé dans le monde merveilleux de l’inconscient.
La troisième m’a cueillie à mon réveil à l’hôpital… après ma première tentative de suicide. Une femme. D’une gentillesse inouïe, douce. Une vraie écoute. Elle m’a conseillé l’hospitalisation… alors j’ai accepté. Dans quoi n’avais-je pas plongé.
Aussitôt transférée dans le secteur psychiatrique de Sainte-Anne, voilà que je rencontre le quatrième psychiatre. L’entrée en matière est un peu rude. Je viens juste de me rendre compte que je suis enfermée, privée de liberté et que ça n’a rien à voir avec ce que naïvement je concevais des soins : de l’art-thérapie, des séances de yoga, du jardinage… Mon dieu, que je suis encore niaise. Alors j’accueille le quatrième psychiatre en lui disant entre deux sanglots que la prochaine fois, je ne me raterais pas. Que c’est bien beau les tentatives mais que la prochaine fois ce sera un suicide tout court. Il est brutal, petit, grossier et moche. M’assène des phrases comme « C’est affreux » quand je lui confie que j’ai un bébé qui m’attend à la maison. Comme si je ne le savais pas que j’ai cette part de monstruosité, que la situation est horrible. Et puis il veut me garder enfermée. Alors 72 heures plus tard, au moment où on m’autorise enfin à quitter les murs de Sainte-Anne, il m’assène que je suis peut-être bipolaire, que les antidépresseurs vont peut-être révéler ce trouble vu mes antécédents psychiatriques. Que si je recommence à vouloir me tuer ; dans son service lui s’en fout royalement, il pourra dormir sur ses deux oreilles, mais qu’il en a connu des patientes comme moi, souriantes, avenantes dont on ne voit pas la maladie et qui en ont fini pour de bon avec la vie. Et que si je recommence en dehors de l’hôpital psychiatrique ce sera la dévastation pour mes proches. Je me mets à pleurer, lui demande quel espoir j’ai. Il me répond qu’il s’en fout d’être l’odieux connard, qu’il m’aura prévenu. En fait, il en a trop vu. Et moi, en trois jours, je l’ai déjà trop vu. Ses paroles en revanche je les ai imprimées ; je ne suis bonne qu’à ça, déprimer et recommencer.
Déménagement. Je retrouve le premier psychiatre que j’ai rencontré, celui des Urgences de la petite ville de province. Pas vraiment par choix. Au centre médico-psychologique c’est le seul qui soit disponible dans un délai raisonnable. On se demande bien pourquoi. J’ai un vague espoir de m’être trompée et que ce ne soit pas lui mais mon espoir est vite douché. En plus, pas moyen d’y couper, j’ai besoin de mon ordonnance. Alors j’y vais. Toujours la bonne élève, la bonne patiente. Mais ça ne manque pas, je recommence comme m’avait prévenu le psychiatre de Sainte-Anne. J’avale du xanax et des somnifères, trop bien sûr. Réveil aux Urgences à l’hôpital. Passage obligé par la case psychiatre avant d’obtenir mon bon de sortie. Il s’appelle Moïse celui-ci. Va-t-il me tirer des eaux troubles dans lesquelles je nage ? Au moins, il semble gentil. Quand il parle, je ne comprends pas tout, ce sont des métaphores un peu brumeuses. Mais j’obtiens mon ticket de sortie sans passer par la case hôpital psychiatrique, c’est toujours ça de gagné. En dehors, je retrouve l’autre psychiatre. Je lui avoue tout. Et là, la phrase que je garderais gravée dans ma mémoire : « Vous savez, si vous continuez, vous allez fatiguer tout le monde, à commencer par vos proches ». Accompagnée de cette sentence : « Il faut que vous changiez votre manière de penser ». Ah mais oui, bien sûr, tout s’éclaire, il suffit de changer sa manière de penser. Pourquoi ne l’ai-je pas fait plus tôt ? Aussi simple à dire qu’à mettre en action…. Là, c’en est trop, je me rebelle et ruse pour ne plus jamais avoir affaire à lui. Je me débrouille pour retrouver Moïse. S’il ne m’a pas sorti de mon marasme, il a au moins le mérite de ne pas m’enfoncer davantage.
Les séances avec lui sont… spéciales. Je ne pige pas grand-chose. Il parle de pansements, de plaies à vif, de cicatrices. C’est bien beau mais je ne suis pas là pour une blessure de guerre. La mienne ne se voit pas. Et puis il accède à mes désirs, sans doute trop facilement. Je suis dans une phase où ça va bien. Alors je lui demande d’arrêter les antidépresseurs. Il acquiesce. En un mois, je devrais être sevrée de ma pilule quotidienne. Mais ça ne manque pas, retour aux Urgences. Des médicaments, trop de médicaments. Et du Doliprane pour me faire du mal. Cette fois, Moïse est ferme. Le bon de sortie, je peux oublier. Il veut me faire hospitaliser. Je fugue. Ils m’ont laissé mes vêtements. J’arrache la perfusion, me rhabille et file en chaussettes jusqu’à chez moi à dix heures du soir. Mon mari est catastrophé, il ne sait pas comment me faire entendre raison. Il arrivera à me faire entendre raison. Direction l’hôpital psychiatrique.
Là, c’est une sixième psychiatre qui m’accueille. Celle-ci ne me laisse que peu de souvenirs. Il faut dire que je ne l’ai vu à peine que deux fois 30 minutes. Avec elle, je découvre deux nouvelles molécules. Un anxiolytique et hop, un autre antidépresseur.
Déménagement, une deuxième fois. Il faut trouver un nouveau psychiatre (on en arrive au septième !). Je n’ai pas l’ombre d’un commencement d’idée pour savoir qui choisir. Je me rends sur Doctolib et choisis une femme au hasard. Son cabinet est compliqué d’accès mais je finis par y arriver. Celle-ci est soignée : un maquillage apprêté, de nombreux bracelets aux poignets, des bagues qui étincèlent. Elle m’écoute dérouler mon histoire. A force de la répéter, je commence à la connaître par coeur cette histoire. Sauf que cette fois-ci la psychiatre m’interrompt : « Mais si vous faisiez une simple dépression post-partum, là au bout d’un an et demi, on serait en train de se dire au revoir. Vous êtes sûrement bipolaire ». Paf, le coup de poignard. La bipolarité ? Il n’en est pas question. Tant que cela reste une dépression, il y a un espoir de guérison. Mais la bipolarité c’est un grand, voire un gros, mot, c’est à vie. Et puis, elle ne me connaît pas cette femme. Elle ne sait quasiment rien de moi. C’est quoi ce diagnostic à l’emporte-pièce ?!
Pourtant, je lui reste fidèle. Pas le courage de chercher un nouveau psychiatre, de tout reprendre depuis le début. Les séances se poursuivent par Zoom, la faute au confinement. C’est compliqué par Zoom de se livrer. Je ne suis de toute façon pas en confiance quand arrive ce qui devait arriver. J’avale des médicaments, toujours trop de médicaments. De nouveau, un psychiatre (le huitième, mais là je commence à perdre le compte) aux Urgences qui me laisse sortir vite. Maintenant j’ai appris la leçon, je sais quoi dire pour ne pas terminer enfermée dans une unité psychiatrique. Il gobe tout. De toute façon, l’hôpital est saturé, autant me laisser repartir.
Il s’agit de retrouver ma psychiatre habituelle. A cette séance, celle-ci ne me laisse pas le choix. Elle ajoute une nouvelle molécule en plus des antidépresseurs : un régulateur d’humeur. Et me reparle de bipolarité. Mais cette fois-ci l’idée a eu le temps de cheminer, j’accepte de la considérer. Après tout, je suis tellement mal. Et si c’était vrai ? Tant pis pour la guérison, va pour les comprimés. Il est temps d’acheter un pilulier.
A la rentrée, changement de décor. Je retrouve ma psychiatre mais le cabinet a laissé place à une clinique privée. La psychiatre a recouvert ses jolies tenues d’une stricte blouse blanche. Seule fantaisie : les bijoux sont restés. Et puis à chaque fois, je ne peux m’empêcher de jeter un regard à ses pieds. Les mois passent : les ongles vernis viennent remplacer les baskets…. Je ne sais plus exactement quand cela arrive mais la psychiatre réussit à me faire baisser la garde. La psychiatre m’écoute. Vraiment. La question « Comment allez-vous ? » attend une réponse. Elle n’est pas là pour délivrer au plus vite son ordonnance, elle prend le temps. Bien sûr moi, j’ai encore la boule au ventre avant de la retrouver. Je redoutais tellement chacune des séances avec ses prédécesseurs, tout ne peut pas changer du jour au lendemain. A chaque fois, j’ai une demi-heure pour me préparer, le temps du trajet.
Peu à peu, je me raconte. Je confie mes angoisses, mes pensées suicidaires. La psychiatre me regarde dans les yeux, d’un air grave. Elle opine. Oui, il n’y a rien de pire que la douleur psychique, oui, il n’y a rien de tel qu’une crise d’angoisse. Pas de jugement. Juste l’accueil.
Certaines fois sont plus éprouvantes que d’autres. Quand je suis au fond du gouffre, je décris : la boule au ventre, l’envie de vomir, l’incapacité à dormir, l’envie d’en finir. La psychiatre me laisse aller au bout de mes pensées. Réfléchit. Elle ajuste le traitement mais n’empile pas les molécules les unes sur les autres. D’autres sont plus légères. Quand je vais bien, je pose des questions. On échange : sur nos métiers, l’actualité, quelques banalités.
Avec le recul, je me dis que j’ai une chance inouïe. D’un seul clic de souris, j’ai réussi à trouver de l’humanité. La valse des psychiatres est terminée. Un an s’écoule, deux. Je reste fidèle. Je prends mes rendez-vous bien à l’avance car je ne suis pas la seule à apprécier les qualités de cette psychiatre.
La maladie, elle, ne connaît pas de répit. Une nouvelle fois, j’avale des médicaments. Une psychiatre aux Urgences. Je m’excuse de la déranger, de lui faire perdre son temps. Promis je ne voulais pas mourir, je voulais juste dormir. Peu après, je recommence. Atterrissage en réanimation. Je dors plusieurs jours avant de rencontrer une dixième psychiatre. Je ne sais même plus ce que je lui dis. Je suis encore trop shootée, tout se mélange. Mais j’échappe à l’hôpital psychiatrique. Je retrouve ma psychiatre à la clinique. Celle-ci m’attend, est déjà au courant, n’émet aucun jugement. Elle ne me lâche pas la main. Bien sûr, elle augmente les médicaments mais pas seulement.
Et puis à mon grand étonnement, je demande à me faire hospitaliser en clinique privée. Je serai suivie par ma psychiatre. Sauf qu’une fois arrivée, c’est un homme qui entre dans ma chambre. Ma psychiatre a eu un empêchement, il la remplace au pied levé. En une demi-heure, il a le temps de me dérouler son CV. Ses faits d’armes, sa retraite, ses nouvelles activités bénévoles. Pour une fois c’est moi qui écoute, un brin médusée. Il cherche à m’impressionner ? Je me demande bien pourquoi, je ne suis qu’une petite jeune femme aux trop nombreux médicaments. Il est question de lithium Ma psychiatre me manque.
Pas longtemps. Je la retrouve dès le lendemain, la supplie de m’en aller. Décidément, les hospitalisations ce n’est pas ma tasse de thé. Vite, je reprends le rythme régulier : une demi-heure tous les mois, une ordonnance à chaque fois. Quand c’est ma psychiatre qui me confie qu’elle a besoin d’être opérée, d’être en convalescence. Les situations sont inversées. Pendant plusieurs mois, je vais devoir m’en passer. Je ne l’aurais jamais cru mais ces rendez-vous vont me manquer. Les ordonnances sont bien là mais ça ne suffit pas. La boule au ventre avait disparu, je la voyais à chaque fois avec plaisir.
Mais surprise ! Arrive le douzième psychiatre. Attention, lui est un expert. C’est du grand ponte. Il a été appelé à la rescousse par ma psychiatre habituelle qui me voyait douter de son diagnostic de bipolarité. Il pourrait être mon père : cheveux gris, chemise et pull bleu ciel. Il est doux, il m’écoute dérouler toute ma vie à commencer par mes nombreux déménagements (Le pauvre, en me demandant d’où je venais il ne savait pas dans quoi il mettait les pieds). A la fin, ses conclusions sont sans appel : je ne souffre ni de dépression post-partum ni de bipolarité, je suis atteint de troubles anxieux. Ça me fait une belle jambe ça. « Troubles anxieux », vraiment ça ne claque pas comme nom de maladie. Et puis mes proches, que vont-ils dire mes proches ? Ce n’est pas une pathologie, tout le monde est anxieux, de là à en faire un diagnostic… Et puis surtout il me dit que j’entretiens moi-même le cercle vicieux de l’angoisse par des stratégies d’évitement. Euh… ben oui j’ai envie de dire : si on a peur de l’avion, on ne prend pas l’avion point barre. Et moi si j’ai peur de quitter mon mari, je ne quitte pas mon mari point à la ligne. En plus, il ne m’a vue qu’une heure et demie, un peu vite pour tout chambouler et tout remettre en cause. D’autant qu’il veut changer le traitement : avoir un recours massif aux antidépresseurs. Moi, quand j’entends les mots « recours massif » ça suffit à me rebuter. J’aime bien les médicaments mais merci, non merci.
Maintenant, il s’agit de ne plus ajouter de psychiatres à cette triste addition. Plus de passage aux Urgences, plus d’hospitalisations, plus de soi-disant experts. Juste ma psychiatre habituelle. Qui elle va devoir me supporter encore quelques années. Quel que soit le diagnostic, il s’agit bien d’un traitement à vie, d’un suivi régulier.





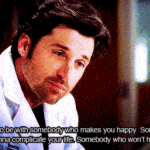
ygans
21 août 2024 chez 13 h 43 minIncroyable récit qui confirme malheureusement ce que je pensais de l’état de la psychiatrie dans notre pays (entre autres choses que bon nombre de psychiatres devraient eux-mêmes avoir une place de choix et prioritaire dans les asile où ils orientent leurs patients).
Ayant longtemps travaillé dans l’accompagnement de demandeurs d’asile parfois victimes de lourds psycho-traumas, je ne compte plus le nombre de fois où je suis tombé des nues devant l’absence d’empathie rencontrée dans les CMP ou cabinets conventionnés : certains psychiatres ne s’adressaient qu’à moi et renouvelaient les ordonnances sans même prendre une minute pour se renseigner sur l’état du patient que j’accompagnais ; parfois ils se trompaient de médicaments dans les ordonnances ; une fois un psychiatre a dit à un jeune malien qu’il recevait : « j’ai plein de maliennes dans ma clientèle, je vous en présenterai si vous voulez, ça vous fera du bien » ; le même, un jour, plaisante avec un de ses patients : « rasez-vous la tête, ça vous aérera le cerveau » (résultat : la personne s’est rasée la tête) ; un autre patient est ressorti de l’hôpital sans ordonnance après une crise lors de laquelle il tout cassé dans son appartement – il a par la suite été condamné à payer plus de 15 000 euros pour des préjudices causés à des infirmières de l’hôpital (cette personne touchait 900 euros par mois d’AAH) ; ou encore des injections tellement puissantes que le patient passait la journée à se baver dessus et pouvait à peine parler et marcher (sans aucun autre suivi psycho-thérapeutique mis en place)…
Sans vouloir dénigrer l’ensemble de la profession, j’en viens à me demander comment sont formés les psychiatres et comment se fait-il que ce métier soit à ce point rempli de dangereux psychopathes grassement rémunérés ?