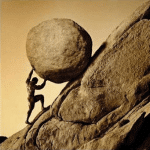Qui sont les « bons schizophrènes » ? [traduction]
Merci à Lau pour cette traduction!
« Quand vous êtes désigné comme fou, avoir « le bon » type de diagnostic peut faire la différence entre une vie productive et une condamnation à perpétuité. » Esmé Weijun Wang
[Cet article est traduit de l’article Who gets to be the « good schizophrenic » ? , initialement paru en anglais sur BuzzFeed.]

Esmé Weijun Wang
Chaque matin, je prends une petite pastille rose ; chaque soir je prends un et demi du même médicament rose. C’est, comme me l’explique mon psychiatre, ce qui m’a permis de fonctionner ces deux dernières années sans hallucinations ni délires. Mais quasi pendant toute l’année 2013, j’ai été une épave psychotique. J’appelle cette année « Mon année de mort ». Mon grand-père, que j’aimais, est mort, et j’étais trop cinglée pour pouvoir aller à son enterrement. En prime, mon année s’est terminée avec un sérieux délire psychotique appelé « Syndrome de Cotard », qui m’avait amené à penser que j’étais morte. J’ai passé quasi toute mon année à combattre des idées persécutantes : il y avait des araignées dans mon cerveau, mon mari avait empoisonné mon thé, il y avait des caméras m’espionnant dans chaque recoin de mon appartement, etc.
2013 a aussi été l’année où j’ai dû renoncer à mon dernier signe extérieur de santé mentale, autrement dit mon travail à plein temps dans une start-up en pleine croissance. Pendant des années, arriver à conserver un emploi avait été ce qui, comme je le pensais sincèrement et peut-être un peu désespérément, me différenciait des autres malades. Mais j’ai dû quitter mon poste parce que mon emploi, malgré divers arrangements, exacerbait ma maladie.
En 2006, étudiante en licence à Stanford, j’ai commencé à présenter les symptômes d’un trouble schizo-affectif de type bipolaire, qui peut être décrit comme le mariage d’une schizophrénie et d’un trouble bipolaire. Le trouble schizo-affectif fait partie de la liste « Schizophrénie et autres troubles psychotiques » dans le DSM-5, et n’est pas une des 5 sous-catégories de la schizophrénie elle-même. Quoi qu’ils en soit, les deux troubles partagent le point 295 du DSM où sont décrits trois troubles – la schizophrénie, le trouble schizophréniforme et le trouble schizo-affectif – et sont du coup considérés comme apparentés.
Pourtant, mon diagnostic officiel – celui enregistré dans mon dossier médical – n’est devenu « trouble schizo-affectif » qu’au moment où je suis tombée tellement malade qu’on m’a prescrit un traitement par électroconvulsivothérapie (NdT : plus connue sous le nom d’électro-chocs). Mon trouble avait été suspecté, mais jamais officiellement diagnostiqué, en partie parce que le trouble schizo-affectif a un pronostic plus sombre et est plus stigmatisé que la bipolarité, et que même les psychiatres peuvent devenir hésitants face à ce qu’impliquent certains codes du DSM. Et aussi, la psychiatrie fonctionne en soignant les symptômes et pas la cause, ce qui fait que ma médication n’a pas été modifiée au moment de mon changement de diagnostic.
Dans « Blue Nights », Joan Didion fait remarquer que « Je n’ai jamais vu de situation où un diagnostic a amené à un traitement, ni à quoi que ce soit d’autre qu’à une fragilité confirmée, et donc renforcée ». Vivre à l’ombre d’un nouveau « code » n’a eu aucune fonction curative, mais ça a impliqué que « bien fonctionner » serait difficile, et ça m’avertissait du fait que dépasser ce diagnostic serait une manœuvre délicate. Un thérapeute m’avait déjà dit, quand j’avais un peu plus de vingt ans, que j’étais sa seule patiente qui était capable d’avoir un travail à plein temps. Avoir un travail, selon les chercheurs en psychiatrie, est considéré comme la caractéristique principale qui indique qu’on « fonctionne bien ».
Pendant ma première hospitalisation psychiatrique, j’ai rencontré deux patientes qui étaient traitées comme étant très visiblement différentes de nous autres – je les appellerai Pauline et Laura.
Pauline était une personne d’âge moyen, et bavarde.
Laura était la seule autre femme asiatique de l’hôpital, et ne parlait à personne.
Entre patients, nous parlions rarement de nos diagnostics – à cette époque, j’étais diagnostiquée comme étant bipolaire avec des traits de trouble de la personnalité borderline – mais tout le monde savait que Pauline et Laura étaient toutes les deux schizophrènes.
Pauline était amicale, et passait beaucoup de temps à se déplacer dans sa chaise roulante en monologuant de manière décousue à propos des « expérience de contrôle mental des psychiatres ». Ses histoires étaient assez paranoïaques pour qu’on se rende compte qu’elle était psychotique, mais étaient assez réalistes pour être perturbantes pour une personne fragilisée. Dans les périodes les moins cohérentes, ses histoires étaient dissoutes en un non-sens verbal appelé « salade de mots », dans laquelle chaque mot n’était que vaguement relié au précédent, et où l’entier de son discours ne voulait absolument rien dire. Ces problèmes de communication l’avaient amenée à être exclue sur ordre médical des sessions de thérapie de groupe, pourtant habituellement obligatoires. Je traitais Pauline comme si elle était contagieuse. Après chaque interaction avec elle, j’étais contaminée par l’angoisse d’être comme elle, même si à cette époque je n’avais pas encore connu d’épisode psychotique. Peut-être que je sentais la psychose en moi, bien qu’elle soit encore cachée à cette époque.
Et il avait Laura, avec qui je n’ai jamais interagi, parce que j’avais peur d’elle, et de la folie que son existence impliquait. Mais je me rappelle d’elle en train de hurler, alors qu’on la sortait de force des WC, interrompant sa tentative pour se faire vomir ses médicaments. « C’est du poison », criait-elle aux deux infirmières qui la tiraient par les bras. « Ils essaient de m’empoisonner ! Ils essaient de me tuer ! »
Une hiérarchie naturelle s’était mise en place dans l’hôpital, basée à la fois sur notre propre sentiment de « bien fonctionner », et sur l’évaluation que les médecins, les infirmières et les travailleurs sociaux qui nous traitaient avaient de notre « bon fonctionnement ».
Les dépressifs, qui constituaient la majorité de la population de l’hôpital, étaient au sommet de l’échelle, qu’ils soient ou non traités par électroconvulsivothérapie. Comme nous étions à l’Institut Psychiatrique de Yale (maintenant connu sous le nom de Hôpital Psychiatrique de Yale), beaucoup de ceux qui étaient hospitalisés pour dépression étaient des étudiants de Yale, et donc considérés comme des personnes brillantes qui étaient simplement en souffrance face à une situation difficile.
Au milieu de l’échelle, il y avait les personnes souffrant d’anorexie ou de trouble bipolaire – deux troubles qui pourtant ne sont pas directement liés, mais qui étaient ainsi regroupés par l’absence d’autres diagnostics au sein de l’hôpital. J’étais considérée comme faisant partie de ce groupe, et peut-être même qu’on me classait avec les dépressifs à cause de mon statut d’étudiante à Yale.
Les personnes atteintes de schizophrénie, enfin, étaient tout en bas de l’échelle, exclues des thérapies de groupe, perçue comme folles, comme démentes, et comme incapables de s’adapter à la normalité.
J’ai vu cette hiérarchie psychiatrique ailleurs – cette hiérarchie entre ceux qui pouvaient être considérés comme « fonctionnant bien » et « doués », et ceux qui peuvent être perçus comme n’étant capables ni de l’un, ni de l’autre. Un mème très partagé a circulé sur Facebook il y a quelques mois. Il listait les soi-disant avantages de diverses maladies psychiques. La dépression développerait la sensibilité et l’empathie ; le THADA rendrait les gens capables de traiter plein d’informations à la fois ; les troubles anxieux rendraient utilement prudent.
Je savais avant de lire la liste que la schizophrénie n’y apparaîtrait pas.
Comme au sein de chaque groupe marginalisé, il y a ceux qui sont considérés comme « plus adaptés socialement » que les autres.
Etre vu comme un échec par la culture dominante peut amener à vouloir de distancer des personnes du même groupe marginalisé qui sont considérées comme encore moins capable de succès.
Le livre « Furisously Happy : A Funny Book About Horrible Things »(« Furieusement Heureuse : Un Livre drôle au sujet de choses horribles »), de Jenny Lawson, m’a été souvent recommandé comme étant un livre hilarant qui faisait du bien aux personnes vivant avec des troubles psychiques. Lawson, la bloggeuse très appréciée qui tient le blog The Bloggess, a reçu plusieurs diagnostics, notamment la dépression et le trouble de la personnalité évitante. Elle explique dès le début de Furiously Happy qu’elle est sous anti-psychotiques – non pas qu’elle soit psychotique, mais parce que cela diminue la durée de ses épisodes dépressifs. « ll n’y a rien de mieux que d’apprendre qu’il y a un médicament qui peut soigner un terrible problème » écrit-elle, « sauf si tu apprends aussi que ce médicament permet de traiter la schizophrénie (ou éventuellement qu’il tue des des fées à chaque fois que tu le prends) ».
Cette phrase, pour moi, a tracé une ligne sur le sable : ma maladie psychique, et les médicaments que je devais prendre pour la soigner, faisaient de moi quelqu’un d’aussi peu fréquentable qu’une tueuse de fées. Mais si j’avais pris de l’Haldol en traitement d’une dépression, je serais restée du bon coté de la folie.
Lawson, j’ai envie de le penser, essaie d’être honnête mais n’a pas de mauvaise intention. Personne n’a envie d’être folle, et encore moins d’êtrevraiment folle – comme une psychotique. Selon les stéréotypes, les schizophrènes sont vus comme faisant partie des membres les plus dysfonctionnels de la société : nous sommes sans-abris, incurables, incompréhensibles, et nous sommes des assassins. Nous sommes des tueurs de masse comme James Holmes, Jiverly Wong, Maj. Nidal Hasan et Jared Loughner.
Les gens comme Elyn Saks, lauréate du Prix MacArthur, enseignante en droit à l’Université de Californie du Sud, avocate et auteure d’un mémoire acclamé par les critiques sur la vie en étant schizophrène font moins les gros titres.
Dans un article écrit en 2008, Saks raconte : « Quand ma demande de réadmission à la faculté de droit de Yale a été examinée, le psychiatre a suggéré que je devrais commencer par travailler pendant un an dans un travail sans responsabilité, pourquoi pas dans un fast-food, pour me permettre de consolider mes progrès pour mieux m’en sortir quand je serais réadmise à Yale ». Le critère pour qu’on lui donne le droit de retourner dans une faculté de droit de haut niveau comme celle de Yale semblait donc être d’être capable d’avoir un travail, pour prouver qu’elle était de retour parmi les gens productifs – tant la schizophrénie est perçue comme annulant les capacités qui avaient permis dans un premier temps à une personne comme Saks d’entrer en faculté de droit.
Mais Saks est exceptionnelle. Mon désir de me comparer à la lauréate d’un prix d’excellence en dit long sur mon ambition. Ca en dit long aussi sur mon désir de m’éloigner de la réalité de ceux qui ne vivent pas bien avec leur schizophrénie, et qui seraient en difficulté dans tous les cas pour travailler.
Pendant que j’étais en conflit avec ma compagnie d’assurance à propos de ma rente d’invalidité, j’ai péniblement essayé de leur expliquer que je suis incapable de travailler chez McDonald’s, mais que je suis capable de mener une affaire basée sur du travail en freelance. Mettez-moi dans un environnement stressant sans possibilité de contrôler mon environnement ou mon planning, et je commencerai rapidement à décompenser et à avoir des hallucinations redoutables. Par contre, pouvoir travailler à mon compte, même si ça représente tout de même un défi, permet plus de liberté quant à mon planning et exerce moins de pression sur mon esprit. Comme Saks, je « fonctionne bien », mais je suis une personne qui fonctionne bien avec une maladie imprévisible et invalidante. Je pense à cela en contemplant Susan, une femme décrite dans le livre d’Andrew Solomon « Far from the tree », qui est décrite comme répondant bien à la médication anti-psychotique : « Par moment, il y a des petites choses qui se déclenchent ici et là, mais ça dure seulement un jour ou deux. Certaines personnes, quand elles sont stressées, leur dos les lâche. Moi quand je suis stressée, c’est mon esprit qui me lâche. Mais après, il revient ».
Je n’ai surement pas le « bon genre » de folie. Parfois, mon esprit me lâche, et je me retrouve effrayée à l’idée qu’on empoisonne mon thé ou qu’il y ait des cadavres sur ma place de parc. Mais après il revient.
Vu que je suis capable d’accomplir des choses, je ne me sens pas à l’aise avec des personnes visiblement psychotiques, ou avec des personnes schizophrènes dont on s’attend à ce qu’elles ne dépassent pas un certain niveau sur la Sacrosainte Evaluation de leur Fonctionnement. Ma tendance à éviter les Pauline et les Laura perdure, et à vrai dire elle s’est même renforcée quand mon diagnostic a été modifié et est devenu plus proche du leur.
Je suis mal à l’aise, parce que je n’ai pas envie d’être associée au gars qui hurle dans le bus, ou à la femme qui raconte des trucs décousus dans un hôpital psychiatrique.
Je suis mal à l’aise parce que je sais que ces personnes, sur plein d’aspects, sont proches de moi d’une manière que les personnes qui n’ont jamais vécu la psychose ne peuvent pas comprendre, et parce qu’en les fuyant, c’est une grand part de moi-même que je fuis.
Dans mon esprit, il y a une ligne entre moi et les personnes comme Pauline ou Laura ; mais pour les autres cette ligne est mince, voire tellement négligeable qu’il n’y a pas de ligne du tout.