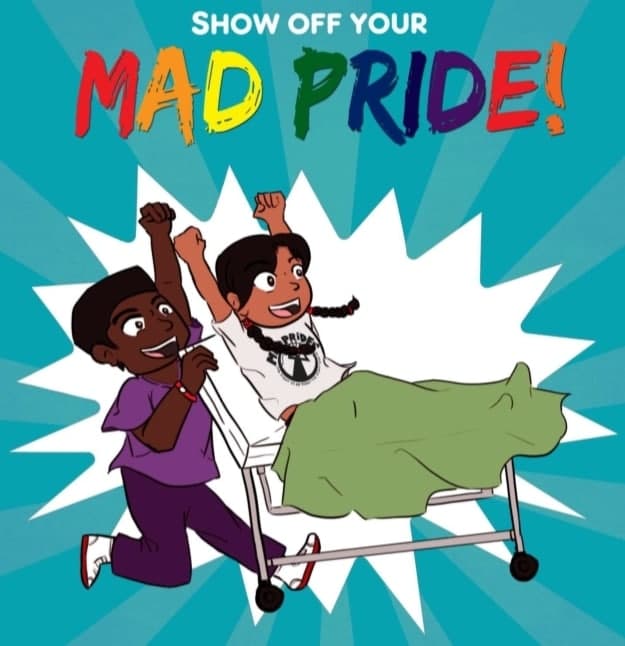«Mère Adrénaline
Brautigan, p. 59
Avec ta robe de comètes
Tes chaussures d’ailes vives et
Ton ombre de poisson volant
Merci de te pencher sur ma vie
De la comprendre et de l’aimer
Sans toi, je suis mort.»
Frôler les ailes de la mort, à l’âge de 37 ans, n’a pas fait de moi un être qui a trouvé un sens transcendantal à son épreuve. Non. Ce qui ne m’a pas tuée ne m’a pas rendue plus forte, mais a arraché durablement quelque chose de nécessaire à mon existence: un souffle, une consistance, un avenir, une illusion de permanence…
Devant la mort et ses accessoires (la peur de mourir, la peur de la mort, les tentations du néant, les cadavres dans les placards, les enfants jamais nés, les histoires de fantômes, etc.), et bien, notre société du «progrès» est bien pauvre en consolations efficaces sur ces réalités si humaines. Bien muette aussi, en dehors des injonctions: «Faut profiter, faut aller de l’avant, la vie continue, t’es en vie, mesure ta chance, faut voir le positif… » On doit promettre au psychiatre de ne pas se suicider, c’est mortel, un peu comme si le cardiologue vous disait: «Je ne veux pas vous soigner tant que vous bouchez vos artères.» Mais le malheur qui nous arrive n’est pas un état d’esprit qu’on peut trafiquer avec la pensée positive, ni un trouble de la personnalité qu’on peut corriger par la magie d’un protocole. C’est une blessure assassine qu’il faut panser.
Alors, sous la tyrannie du bonheur, on se tait. On tue la mort. Y penser devient une honte. Un bloc de fonte en travers de la gueule et de l’âme. Ne pas y penser devient angoisse. Et l’angoisse est pire que la mort. Je la déteste. Elle rend la vie hideuse. Absurde.
J’étais une personne, jusqu’à ce matin où j’ai fait deux malaises en sortant de la boulangerie avec mes foutus croissants, et j’allais devenir une autre personne, en quittant l’hôpital une quinzaine de jours après. Les moments les plus critiques de mon sauvetage héliporté et de la prise charge de «mon» embolie pulmonaire massive ne sont qu’une explosion d’onomatopées audiovisuelles, de sensations primitives et l’idée d’une douleur sans rebord qui m’engloutissait. Un état de choc est-il seulement soluble dans le langage? Je n’ai jamais eu aucun problème à me confronter à ces souvenirs, ni à les penser à la 1re personne, ni à en mesurer la gravité, car je les ai créés de toutes pièces après coup en m’appuyant sur les récits des médecins.
En revanche, des 3 jours d’agonie qui ont précédé, il ne me restera qu’un fatras de particules intrusives. Effacés en partie par les bêtabloquants et benzodiazépines prescrits en masse par le médecin du quartier que j’ai consulté en urgence. Médecin peu enclin à prendre au sérieux les symptômes alarmants de «la petite dame»: «Mais, c’est rien de grave… Juste un peu de stress au travail, faut vous reposer ce week-end.» Trois jours, recroquevillée sur mon état qui empirait, avant d’oser appeler l’ambulance, avant de pouvoir le faire. J’avais si peur de déranger pour rien. J’avais si peur qu’on m’embarque tout droit à l’asile psychiatrique pour une maladie imaginaire. Dès lors, l’oubli restera vivace et ne cessera de torturer ma santé. Mon corps se mettra à hurler à tort et à travers et à trembler la nuit. Il ne tenait plus en place, comme un gosse épouvanté par le silence.
Les souvenirs du pire surgiront 18 ans après, à la faveur d’une somatopsychothérapie qui me permettra d’éplucher un à un les traumas qui recouvraient mon identité et d’intégrer la mort dans ma vie.
En écrivant ces mots, je pense à cette nuit d’été, gisante sur le carrelage glacé, incapable de bouger sans m’évanouir ou vomir, au plafond qui gondole, au téléphone si inaccessible… Je pense à la marée noire qui me submerge, à cette houle qui brûle mes poumons, aux pulsations urgentes de mon coeur, à mon cerveau qui psalmodie «çA VA – çA IRA – çA VA – çA IRA – çA VA – çA IRA…» pour ne pas dériver vers ce lieu informulé qui m’ouvrait ses bras.
En revenant de loin, je troquais le cocon des soins pour l’enfer du travail avec tous ses nuanciers de fatuité, de servitude et de méchanceté. J’ai retrouvé ce qu’on nomme par commodité le «mobbing» (sans doute préférable aux périphrases: rituel moderne de mise à mort lente d’une victime sacrificielle ou chasse aux sorcières) dont j’étais la cible, exactement là où je l’avais laissé.
«Je hais
Parce qu’ils sont mauvais
Comme la faim habituelle
Dans un estomac d’enfant
Les gens qui essaient
De changer l’homme
Le chercheur de vérité
En taureau castré
Paissant
Dans la paix
De la mort mentale.»
En temps normal, je me serais enfuie sans autre forme de procès, car j’avais toujours été la reine de l’évasion. Mais là, ma volonté était pétrifiée. Elle était dans une autre dimension. Celle de la matière. Celle de ma corporalité qui hébergeait quelque chose d’horrifiant et empêchait mon âme d’imaginer le Mieux.
Cette coïncidence d’épisodes mortifères, combinée à mon propre terrain déjà miné, a marqué le début d’une bascule dans une existence secondaire. Dans un grand sommeil agité. J’étais la pluie qui cherchait son nuage. Je déchiffrais le monde à travers l’eau, déformé, sourd, vacillant. Tout nageur était déjà un noyé. La décennie qui a suivi est une expédition dans un paysage en désolation, jusqu’à l’épuisement de mes capacités de résilience. Jusqu’à mon obtention de l’assurance-invalidité, étrennée par 6 semaines
suspendues au-dessus de l’abîme, à attendre le résultat d’une biopsie: tu meurs ou tu meurs pas.
Marlowe est un Golden Retriever blondinet, qui a 3 ans aujourd’hui. La décision d’adopter un chiot s’est imposée à moi comme une fulgurance. Ma vie rétrécissait. Elle ne voyait pas ce que j’irais faire plus loin. Partout où je me dirigeais, la gueule de la réalité gardait les cieux grands fermés. J’étais lasse de m’accoucher à chaque réveil. J’ignorais tout du monde canin, mais quelque part, dans la banlieue de ma conscience, j’avais gardé en mémoire le lien vital et puissant qui m’unissait aux animaux, particulièrement aux chevaux, durant mon enfance.
Un chien est un chien. Tout ce qu’on dira de lui ne sera que projections. Forte de cette tautologie, je savais que je ne pouvais lui reprocher ni mes tensions, ni mes exaspérations. Les premières semaines avec Baby Marlowe ont été éprouvantes. Je n’arrivais pas à aimer cet intrus qui refusait de se comporter comme le chat. En m’infligeant ses nécessités et son énergie vitale, il faisait voler en éclats toutes les sécurités qui quadrillaient mon emploi du temps. J’étais terrifiée. Sa jubilation d’Être m’agressait, tant elle mettait en relief les pensées couvertes de miasmes qui m’assaillaient: «Vais-je survivre? Ce chiot ne m’aime pas, je suis indigne de cette créature, pauvre bête qui grandit dans mes angoisses, je suis une vraie nullarde de mère, je suis totalement infoutue de m’occuper de cette créature, qu’est-ce que je fais faux? Je vois bien qu’il s’emmerde avec moi, si je n’y arrive pas… je me flingue…» Lorsqu’il dormait, étalé dans toute sa plénitude, je le regardais bouleversée, moi qui ne savais pas me reposer sans un Whisky-Temesta. Chaque jour, je devais puiser dans mes tréfonds le courage d’assumer la responsabilité que j’avais endossée: faire de cette bête un chien équilibré et heureux.
Les premiers temps, je m’occupais de mon chiot avec une sorte de distance clinique, comme si j’étais un employé zélé qui s’acquittait de tâches de soin ou d’éducation et respectait scrupuleusement des horaires.
Comme si je m’apprêtais à passer un examen vital en éducation canine. Je trimais comme une dingue de 7 heures à 21 heures, 7 jours sur 7. Tel Sysiphe, je remettais chaque jour l’ouvrage sur le métier: pipi, popot, promenade, dodo, miam-miam, baballe, pipi, au pied…
Or, contre toutes attentes, ces corvées se muèrent peu à peu en une sorte de mystique de l’ordinaire qui m’emplissait des petites joies du «faire».
Ma vie échappait à toute rationalité. Je déambulais cradingue dans les rues, en parlant-bébé à mon chiot, les poches remplies de friandises et de jouets qui font «pouic-pouic», on allait à la gare observer les trains, au marché contempler le mouvement du monde, on surmontait le vide des grilles et des passerelles, on creusait des tranchées à la plage, on jouait au bâton qui revient encore et encore, on coursait les mouettes en aboyant…
«Parfois je sors mon passeport
Brautigan, p. 343
Regarde la photo de moi
(pas très bonne, etc.)
Juste pour voir si j’existe.»
Si m’habiller, me laver, enfiler non pas une, mais deux baskets (après deux chaussettes) restaient encore des actes herculéens, dès que je franchissais le seuil de ma porte avec mon chiot frétillant, mon petit Moi haïssable se confiait à l’oubli. Une énergie se décantait à l’intérieur de moi. Du vent soufflait dans mes semelles. Chaque jour, je m’aventurais toujours ailleurs, toujours plus loin. Je découvrais les friches et les sous-bois de la ville, ses parcs et ses fontaines. Puis ses environs sauvages le long des cours d’eau délurés. Je me laissais guider par mon chien hors des sentiers battus.
L’espace d’une balade, je parcourais ce que mon espèce a vécu en des milliers d’années, le redressement
de ma colonne vertébrale. Mon horizon bâtissait ses racines. Les forêts sont devenues mes cathédrales végétales grouillantes de créatures mystérieuses et de forces telluriques.
«Ô vie
Brautigan, p. 47
Ô beauté
Ô merveilleuse splendeur de toutes choses
(Eh mec, prends une aspirine avant que tu ne fondes un plomb)»
Sous prétexte d’imprégner mon chiot de toutes sortes de situations, je prenais mon toutou partout, comme un doudou. Sa présence à portée de main me tient à l’écart de la claustrophobie, surtout en présence de mes congénères.
Un chien n’a pas de montre. Il n’est jamais en retard, ni calculateur. J’apprenais à meubler mes impatiences, en improvisant. J’apprenais à ne plus «m’attarder dans les ornières du résultat» (René Char). Pendant les dodos de Marlowe, je me suis mise à cuisiner, non plus pour «boucher un trou» avec les 5 fruits-légumes, mais pour le plaisir de me nourrir. Les petits matins d’insomnie, je pratiquais les pages d’écriture automatique.
Mon temps qui, jusque-là, se ramassait sur lui-même en des mouvements crantés de spirales imbriquées et de girations froissées, se mettait à déplier une fluidité. Lorsque je marchais avec Baby Marlowe, un œil sur ses déplacements erratiques (un chiot, ça trottine en zigzaguant, ça stoppe net pour muser, ça toupille, ça décampe au triple galop, ça se roule dans la boue…), mon attention était attirée par la pluie sur mes joues, le parfum de l’aube qui flânait dans mes narines, les textures du sol qui me supportait, les coassements des grenouilles au loin, les rumeurs de la nuit, les miroitements des flaques… Marlowe m’entraînait sur les traces de mon enfance et de sa densité. Là où réside une forme de légèreté et de grâce dans le simple fait d’exister, là où le langage n’a pas encore bridé les sensations, là où les humains n’ont pas encore piétiné l’insouciance.
Grâce à ces expériences, ma mémoire se constituait un album de bonnes sensations, qui m’aiderait bientôt à affronter ou à titrer la charge émotionnelle des catastrophes qui tapissaient mes amnésies traumatiques. Sur ce chemin de la revivance, un violent orage a déferlé. La confrontation brutale avec la finitude et la vulnérabilité de mon chiot à 6 mois, lors d’une visite chez le vétérinaire à la suite de boiteries entêtantes. Le diagnostic était sans pitié: dysplasie sévère des coudes avec nécessité de tenter une double arthroscopie, sans quoi Marlowe ne pourrait pas vivre sans d’épouvantables souffrances. Ce qui aurait dû m’abattre m’a au contraire propulsé au coeur de mon «invincible été».
«Je pourrais te porter à travers l’enfer
Brautigan, p. 299
Et
Si tu avais oublié ton chapeau
Je traverserais
L’enfer à pied
Pour aller te le chercher.»
Comme un médecin de l’urgence qui sauve la vie, sans compter, j’ai pris la décision la plus rapide depuis des plombes: ce chien vivra.
Ce chien sera opéré quoi qu’il m’en coûte (une putain de blinde pour une AIste!). J’étais le rugissement du lion de la Goldwin-Meyer. Les oiseaux de mauvais augure «ce n’est qu’un chien… tu vas pas t’endetter pour une opération qui ne garantit rien… faut l’euthanasier… comment tu vas faire pour garder ton chien au calme strict pendant quatre semaines…» ne figuraient pas dans mon scénario.
Ensuite, j’ai accompagné chaque pas de la convalescence de Marlowe, comme une infirmière des soins intensifs du CHUV, avec une sollicitude et une bienveillance sans limite.
«ÇA VA – ÇA IRA – ÇA VA – ÇA IRA – ÇA VA – ÇA IRA…
Inspire
Tu es fragile
Mais tu peux à nouveau te cogner à la vie…»
Virginie Oberholzer
Poetico-graphie:
R. Brautigan. Pourquoi les poètes inconnus restent inconnus. Edition bilingue. Paris: Points/Le castor astral; 2016.
R. Brautigan. Il pleut en amour. Journal japonais. Edition bilingue. Paris: Points/Le castor astral; 2003.
Texte initialement paru dans Swiss Arch Neurol Psychiatr Psychother. 2022;173:w10013. doi: 10.4414/sanp.2022.w10013