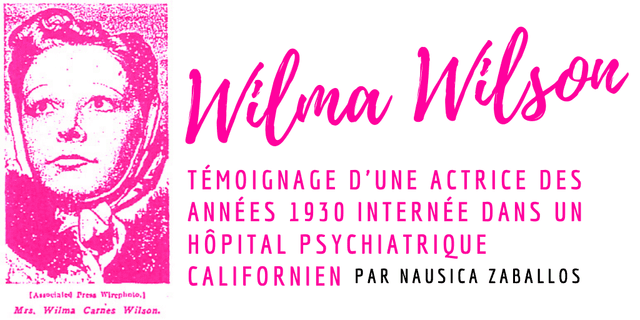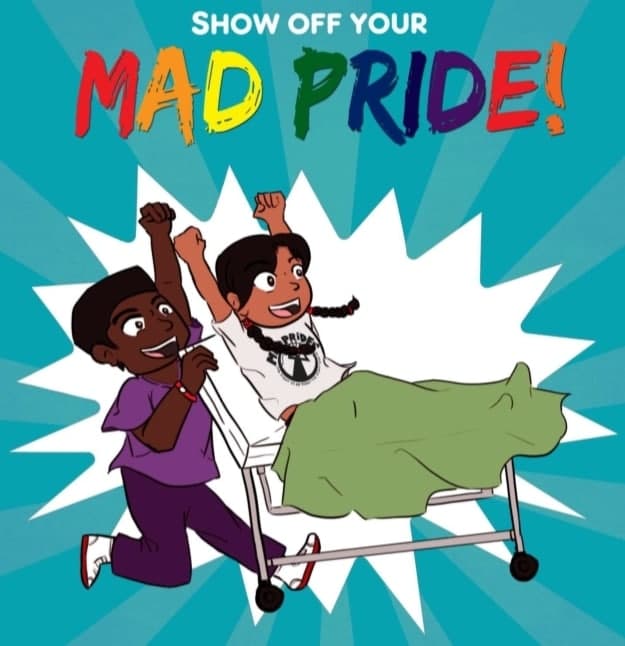« On les appelle Camisoles » : la carrière, outre-tombe, de Wilma Carnes Wilson, starlette alcoolique internée, auteure féministe divorcée et rousse incandescente assassinée.
Le Camarillo Hospital, hôpital psychiatrique californien, ouvrit ses portes en 1933. Jusqu’à sa fermeture, en 1996, il suscita un vif intérêt tant de la part de l’opinion publique que des législateurs ou de la communauté médicale. Reconnu comme un lieu pilote pour l’innovation thérapeutique grâce à notamment ses partenariats avec l’université de Californie à Los Angeles (UCLA), il fut également l’objet de controverses suite à des dénonciations de maltraitances. En 1976, un Grand Jury fut saisi afin d’enquêter sur les circonstances dans lesquelles des patients avaient trouvé la mort. Le Camarillo Mental Hospital fit également les choux gras de la presse à scandale en accueillant comme patients des meurtriers tels Elizabeth Mae Duncan[1] ou la baby-sitter étrangleuse, Delora Campbell. L’hôpital se situait près des studios hollywoodiens et de nombreuses célébrités au nombre desquelles les musiciens de jazz Charlie Parker et Phineas Newborn vinrent y faire soigner leurs dépressions nerveuses et addictions. Si les stars hollywoodiennes veillaient à ne pas ébruiter leur internement, d’autres patients, se servirent de leur séjour au Camarillo Mental Hospital comme d’un tremplin vers la gloire. Ce fut le cas de Wilma Carnes, dite Wilma Wilson, starlette qui travaillait comme doublure dans les ballets aquatiques tournés à Los Angeles. Elle publia en 1940 aux éditions Lymanhouse un ouvrage intitulé They Call Them Camisoles dénonçant la violence des traitements imposés aux femmes alcooliques internées.
They Call Them Camisoles possède une dimension historique indéniable. De nombreuses informations factuelles agrémentées d’analyses subjectives aident l’historien à mieux appréhender la relation patient-soignant au sein du Camarillo Mental Hospital à la fin des années 1930. Mais, ce livre est aussi un objet narratif protéiforme qui montre comment le récit d’une patiente psychiatrique échappe aux visées traditionnelles de témoignages d’interné(e)s. L’auteur y endosse de multiples rôles cinématographiques : celui de la fausse ingénue qui utilise son pouvoir de séduction pour adoucir son quotidien au Camarillo Mental Hospital puis celui de la penseuse féministe se dissimulant sous le masque de la femme fatale.
Stratégies de survie d’une fausse ingénue.
Quelles sont les stratégies mises en œuvre par Wilma Wilson pour survivre aux conditions, parfois difficiles, d’hospitalisation sans froisser l’institution psychiatrique ? L’auteur va d’abord se renseigner sur l’univers asilaire. Wilma Wilson précise qu’elle a rapidement envisagé son internement comme la possibilité de réaliser un reportage journalistique, entreprise rappelant d’autres écrits, ceux de Nellie Bly (reporter au New York World) qui simula la folie pour réaliser une enquête sur les conditions d’internement au Women’s Lunatic Asylum Blackwell’s Island. Wilma écrit : « Je développai rapidement un intérêt croissant pour l’hôpital (…) J’interrogeai de manière extensive toute personne qui passait à ma portée. Je posais des questions sur la gestion financière de l’hôpital, les différents protocoles et la variété de traitements. » (Wilson, p.151) Le lecteur apprend ainsi que la superficie de l’hôpital était de 30 yards, que nourrir un patient coûtait 4 cents et demi par jour et que les aides-soignants bénéficiaient d’une paie conséquente pour l’époque –100 dollars- par mois. (p.152)
La réclusion géographique et sociale imposée par l’internement empêchait Wilma d’échapper à sa condition de patiente psychiatrique. Les notes qui ont servi de mémento pour la production littéraire à venir devaient être rédigées sous l’œil de ses compagnes de captivité et de ses gardiens. Pour éviter que son calepin ne soit confisqué par des médecins soucieux de contrôler des informations susceptibles d’être divulguées à la presse, Wilma explique qu’elle le cachait au milieu du linge sale, dans le service de nettoyage auquel elle avait été affectée. Consciente des risques encourus, Wilma mit en place des stratégies pour passer inaperçue au milieu des vrais fous. Afin de poursuivre ses activités d’écrivain sans être importunée, Wilma décida de cacher sa « normalité » à tous. Comme de nombreuses patientes se livraient à l’écriture de manière compulsive et effrénée, il ne lui restait plus qu’à adopter le comportement pathologique de ses congénères : « On pouvait voir à tout moment dans la buanderie plusieurs femmes démentes : elles écrivaient avec furie. L’une d’entre elles écrivait au président, l’autre envoyait sa lettre d’amour quotidienne à Clark Gable alors que Verna, couchait sur papier, ses poèmes pour la gloire. » (p.151)
Même si Wilma Wilson masque une grande partie de ses griefs sous des descriptions humoristiques, ses écrits n’en revêtent pas moins une dimension polémique alimentée par un sentiment d’injustice. Selon elle, la mixité entre publics était une grave erreur. Elle dépeint les efforts déployés par les patients alcooliques pour demeurer à l’écart des « véritables fous » : « Nous nous cachions dans une pièce vide pour éviter autant que possible d’être à proximité des patients psychotiques. » (p.42) Le drame de la patiente Wilma est de devoir occulter aux médecins son regard critique afin d’espérer pouvoir quitter l’hôpital. Le récit de l’apprentie actrice relate ainsi un jeu de dupes plus subtil qu’il n’y paraît au premier regard. Au fil des pages, le lecteur s’interroge légitimement sur la propension des médecins à cerner le « cas » Wilma Wilson.
Wilma : une femme insaisissable, une femme malade ?
Le jugement clinique sur la patiente Wilma, omniprésent dans They Call Them Camisoles, n’est pas une clef d’analyse suffisante pour cerner la personnalité de l’auteur. A contrario, il renforce la critique des médecins dressée par l’ex-patiente. Afin d’adapter son comportement aux attentes des médecins, Wilma Wilson a demandé à une patiente employée comme secrétaire de jeter un œil sur son dossier médical. Wilma réfute la pertinence des critères retenus par les médecins pour justifier son internement. Les expressions utilisées pour qualifier Wilma ne renvoient pas aux troubles psychiatriques dont elle pourrait éventuellement être atteinte mais constituent des jugements moraux. Wilma est ainsi décrite comme une malade désinvolte et séductrice. (p.182-183) A travers le récit de différents entretiens médicaux, Wilma s’évertue à critiquer les critères utilisés pour évaluer l’état mental des patients. Ses sarcasmes, à l’encontre d’un test de QI, révèlent qu’une simple erreur de date ou de calcul pouvait être fatale aux patients : « Je me souvenais des quatre derniers présidents mais les filles durent me rappeler les quatre premiers. Washington, Adams, Jefferson, Madison. J’enregistrais mentalement les quatre premières lettres de leurs noms, juste avant de franchir la porte de la salle d’examen (…) Lorsque les fées se penchèrent sur mon berceau, elles oublièrent de m’offrir la prudence et les mathématiques. Je comptais mécaniquement en me servant de mes doigts cachés sous le bureau. » (p.61-63)
Les entretiens avec les médecins psychiatres, hommes ou femmes, sont présentés comme de parfaits exemples de non-communication : « J’étais assise dans la rangée de patients qui s’apprêtaient à rencontrer comme chaque mardi l’équipe médicale. Je tremblais de tous mes membres. (…) J’étais crispée, comme une accusée au regard défiant. J’eus l’impression que leur froideur m’était entièrement dirigée. J’appris par la suite qu’il est contraire aux règles de réserver un accueil chaleureux aux patients alcooliques. » (p.130) La rencontre tourne à la confrontation car le malade est dépossédé de sa liberté de rétorquer ou d’exiger des explications : « Le docteur ne fit aucun commentaire, ce qui n’était pas surprenant. A ma connaissance, jusqu’à présent, ils n’ont jamais donné de réponse claire et directe à un patient durant un entretien médical hebdomadaire. » (p.131)
La survie n’est garantie que par l’adaptation du patient à son environnement. Constamment en alerte, Wilma Wilson apprend vite quels sont les stratagèmes pour obtenir davantage de nourriture à la cantine, pour être envoyée dans une aile d’hôpital plus accueillante, pour bénéficier d’autorisations de sortie. La nouvelle venue dans l’univers psychiatrique décide également de se choisir des instructrices qui accepteront de partager avec elle leurs stratégies de coping. On retrouve ainsi, bien des années avant sa légitimation institutionnelle, la figure du survivor (survivant aux « mauvais » traitements psychiatriques). Au fil des pages du témoignage se dessine une solidarité féminine qui se dresse face à un monde autoritaire dominé par l’absurde. Wilma et ses compagnes de chambre se jurent de venir en aide aux nouvelles arrivées comme Elise : « Nous avions établi un programme très sérieux pour être en mesure de la surveiller et de la soutenir si nécessaire. » (p.54) Le savoir expérientiel des patientes s’oppose au savoir scientifique des soignants.
Bien souvent internées sur décision familiale pour un comportement jugé contraire aux bonnes mœurs, les patientes alcooliques sont confrontées à une institution qui prône l’acquisition de capacités ménagères comme unique réhabilitation. Un article rédigé par John Abbott et publié le 22 mars 1938 dans le Berkeley Daily Gazette expliquait que les thérapies occupationnelles étaient au cœur du protocole de soin de l’hôpital : « la couture et la peinture pour les femmes, l’apprentissage du bricolage pour les hommes a permis à de nombreux patients de se débarrasser de leurs obsessions tout en découvrant de nouvelles activités. » Alors que Wilma Wilson doit se plier à un rôle de maîtresse de maison en porte à faux avec ses aspirations d’actrice, elle prend aussi conscience qu’elle doit continuer d’user de ses charmes pour adoucir son quotidien. Une compagne d’infortune lui conseille de prendre soin de son apparence : « Suis mon conseil, continue à te maquiller (…) Les hommes qui travaillent à la cafétéria te serviront des portions de nourriture plus importantes. On doit beaucoup flirter pour espérer manger normalement. » (Wilson, p.55) Pour la starlette habituée à se mettre en valeur sur les plateaux de tournage, l’hôpital se meut alors en décor idéal pour faire montre de toute l’étendue de ses talents de séductrice.
L’hôpital : décor de cinéma pour un personnage de séductrice ?
Selon Wilma, l’hospitalisation permet de cacher à l’opinion publique des figures féminines que la doxa ne saurait supporter. Usant et abusant de sarcasmes, Wilma pointe du doigt une institution hospitalière obsolète, car d’un autre âge. Les thérapeutiques occupationnelles en vigueur à l’époque ne soignent pas l’addiction des patients alcooliques. Mais, en se portant volontaire pour aider les aides-soignants au sein du service d’hydrothérapie, Wilma se fait paradoxalement complice d’un système qu’elle pointe du doigt. (p.74) Faire carrière à l’hôpital, c’est avant tout gravir les échelons d’une hiérarchie implicite qui divise les malades en deux groupes : les patients jugés trop instables pour se voir confier une occupation et les autres. La diversité des postes occupés par les patients employés comme main d’œuvre non rémunérée témoigne d’une division des travailleurs en deux groupes : les cols blancs et les cols bleus. D’abord chargée de nettoyer le sol ou de faire enfiler des camisoles à des patientes syphilitiques (p.94-95), Wilma est ensuite responsable du service de la buanderie (p.143) puis autorisée à créer un atelier de chants. Son parcours témoigne d’une véritable ascension professionnelle au sein du Camarillo Mental Hospital : Wilma a réussi sa carrière de patiente. L’ouvrage, parsemé de dessins humoristiques, recèle une illustration qui montre Wilma coiffée de la toque des étudiants américains diplômés. (p.271) Pourtant, malgré la métaphore de l’étudiante appliquée, présente tout au long du récit, l’ouvrage de Wilma Wilson représente un désaveu pour l’institution psychiatrique.
L’auteur ne cache pas qu’elle doute de sa capacité à demeurer sobre dans le futur : « La prochaine fois que je mourrais d’envie de prendre un verre, je m’assommerais en ingurgitant du sirop pour dormir, ou bien je me rendrais malade en avalant de l’ipecac comme vomitif. » (p.268) Cependant, Wilma se défend d’avoir publié un document à charge. Elle met en garde les personnes qui seraient tentées de considérer They Call Them Camisoles uniquement comme une critique de l’institution psychiatrique : « Je ne sais pas contre qui je dirige mes remarques assassines. Je ne vise certainement pas les patients psychiatriques. Ils sont confrontés à des problèmes qui fendent le cœur. Je n’accuse pas non plus les alcooliques (…) Les aides-soignants ? La plupart d’entre eux font preuve de patience, de compréhension et de gentillesse dans des situations très tendues. Les docteurs ? Ce sont des hommes et des femmes stressés, ployant sous le travail, acculés de tous côtés par de malheureuses histoires. L’état ? La Californie croule sous son fardeau de pauvres. » (p.269)
En fait, They Call Them Camisoles se présente comme un tremplin vers la postérité. L’auteur tire d’une expérience douloureuse un récit édifiant qui, en sus de dénoncer les conditions de détention psychiatrique de patientes alcooliques, offre un rôle à contre-emploi à une starlette en quête de gloire. Le récit de Wilma constitue une célébration d’elle-même. Les atermoiements de l’aspirante actrice, reine de l’attitude désinvolte, ne portent pas toujours sur l’enfermement psychiatrique mais bien plus, sur son incapacité à faire bonne figure dans un univers de crasse qui est l’antithèse de la sophistication. Elle est outrée par la taille des serviettes : « Elle avait la taille et la forme d’un mouchoir pour homme et elle avait bien besoin d’être lavée. » (p.49)
Sous le masque de la femme brisée par l’expérience asilaire se cache la fausse ingénue qui tente d’amadouer médecins et juges. Les larmes, pense-t-elle, susciteront la pitié d’un docteur : « Je contemplais l’épaule du médecin. Il avait une belle carrure. Exactement l’épaule qu’il me fallait pour créer l’illusion que j’incarnais Niobé. » (p.64) Wilma pense échapper à l’internement grâce à sa beauté naturelle : « Le juge m’étudia des pieds à la tête. Même si je n’étais pas à mon avantage après une nuit passée en prison (…) j’étais loin de ressembler aux autres prisonniers. » (p.54)
Elle tourne en dérision le psychiatre chargé de déterminer si elle souffre de paranoïa afin de glisser au lecteur que les hommes, fascinés par sa beauté, la suivent régulièrement en voiture dans la rue : « Deux hommes qui conduisaient une Dusenberg me suivirent un jour sur une bonne longueur de rue. Je voulais le dire au médecin mais je pense qu’il ne m’aurait pas prise au sérieux, il aurait pris mes propos pour de la vantardise. » (p.64) Malgré sa tendance à vanter sa plastique, Wilma est bien consciente des dangers à revêtir une attitude de séductrice dans un univers condamnant l’autonomie des désirs sexuels féminins. Wilma Wilson s’apitoie sur le sort d’une jeune femme atteinte de syphilis : « Je rencontrai (…) une fille qui avait passé plus d’un an dans l’aile 6 parce qu’elle était atteinte de syphilis. Je me demande comment elle a fait pour demeurer saine d’esprit. De toute façon, elle était si pleine d’amertume à sa sortie qu’elle a certainement dû avoir un comportement anormal par la suite. » (p.89)
La mention constante de son pouvoir de séduction et les indices semés quant à son irréprochable plastique ne seraient-ils pas destinés aux réalisateurs se trouvant éventuellement parmi ses futurs lecteurs ? En concentrant la narration autour d’événements qui lui permettent de se présenter comme une héroïne de film, Wilma Wilson échappe à la stigmatisation de l’internée. Elle transforme son témoignage en une carte de visite originale à l’intention des studios et elle évite, par ailleurs, de voir son discours censuré. L’auteure mentionne par ailleurs que certains faits devaient être passés sous silence : « On me remit un formulaire sur lequel figurait la question ‘Avez-vous déjà été témoin d’un acte de maltraitance commis par un aide-soignant sur la personne d’un patient ?’ (…) Une petite voix me dit que si jamais je répondais ‘oui’, je pourrais rencontrer des obstacles sur mon chemin vers la sortie. » (p.72) La dimension humoristique du témoignage de Wilma réside dans un comique de situation fondé sur le décalage entre les préoccupations d’une jeune vamp et les exigences d’un système psychiatrique qui, par certains aspects rappelle l’univers carcéral. Mais, la distance humoristique ne doit pas faire oublier au lecteur que la description du quotidien des patientes est placée sous le sceau d’une dénonciation des rôles imposés aux femmes internées. They Call Them Camisoles, discours féministe, dépeint des jeunes femmes contraintes d’embrasser des carrières de femmes au foyer si elles veulent espérer quitter un jour l’hôpital.
En ce sens, il s’inscrit dans la lignée des récits autobiographiques, écrits dès la fin du XIXe siècle, par des femmes dénonçant le recours à l’internement comme moyen de contrôle social par des maris jaloux et possessifs.
Pour mémoire, on se réfèrera ainsi à The Prisoners’ Hidden Life Or Insane Asylums Unveiled publié en 1868 par Elizabeth Packard, internée pendant trois sur demande de son mari, le révérend Theophilius Packard, pour des raisons de divergences religieuses. Le militantisme d’Elizabeth Packard contribua à l’adoption d’une loi accordant aux femmes mariées de l’Etat de l’Illinois la possibilité de bénéficier d’une audience avant d’être internées.
Dénonciation de l’hôpital comme lieu de réhabilitation sociale normative.
Pour les patientes alcooliques, dépressives ou hystériques, l’hôpital devient une école des bonnes manières, étape indispensable vers la réhabilitation sociale. Les dialogues entre médecins, infirmières et patientes retranscrits par Wilma dépeignent des rapports de forces où l’on s’adresse à la malade, infantilisée, comme à une enfant capricieuse. Internées sur décision familiale, ces patientes abandonnent tout espoir d’échapper au joug marital ou maternel. Wilma rapporte ainsi les propos d’une amie : « Si ta famille veut te faire interner de nouveau, ils le peuvent (…) Connaissant bien mon mari, je suis persuadée qu’il voudra que je lui obéisse les yeux fermés au moindre claquement de doigt. Même si je ne me remets pas à boire (…), il recommencera à me faire souffrir en menaçant de me retirer la garde de mon enfant. » (Wilson, p.197)
Selon les médecins, le mariage semble, pour des femmes suicidaires, alcooliques ou dépressives, la seule porte de salut en dehors des murs de l’hôpital. Mais, le seul moyen de trouver un mari pour des femmes ayant été internées est de se transformer en parfaites maîtresses de maison. Une employée conseille à Wilma de garder en mémoire tous les gestes appris au sein de l’hôpital : « ‘Si tu as prévu de te marier, Wilma, tout ce que tu apprendras ici te sera d’utilité pour ton couple.’ » L’auteure ironise : « J’étais dubitative quant à l’utilité de ce conseil. Forcer Ricky [son futur mari] à enfiler une camisole ne me servira à rien. » (p.78-79)
Selon Wilma, l’hôpital psychiatrique, par la promotion de thérapies occupationnelles ménagères, favorisait la reproduction, à travers la relation infirmière-patiente, d’interactions familiales dysfonctionnelles. Le couple mère castratrice / fille acting-out se reconstituait dans la relation infirmière-patiente : « Des mères autoritaires (…) n’acceptaient pas que leurs filles soient devenues des adultes indépendantes. Certaines mères étaient prêtes à tout pour contrôler à nouveau leurs enfants. » (p.198)
D’après Joel Braslow, à l’intérieur des hôpitaux psychiatriques californiens des années 1930, les aides-soignantes étaient les exécutrices d’une conception de la médecine psychiatrique inspirée par des thérapies morales et hygiénistes. Les faits et gestes des patientes étaient épiés par des auxiliaires de soin en surnombre. Lors de l’internement de Wilma Wilson, le nombre de patientes s’élevait à 90 pour plus de 100 aides-soignantes. (Wilson, p.55-56) La réhabilitation sociale passait aussi par l’acceptation d’un règlement qui exigeait de toutes les patientes de fournir des efforts lors de la réalisation de tâches ménagères. Wilma Wilson nettoyait plusieurs kilomètres de couloirs par jour. La laverie prenait en charge les vêtements de plus de 300 patients. L’hôpital était loin d’être le lieu de villégiature espérée par certaines patientes comme Jo, mère au foyer alcoolique, internée sur recommandation médicale afin de se reposer : « Je suis venue ici avec le ferme espoir de reprendre des forces (…) Je me retrouve à la buanderie pour plus de quatre mois ! » (p.138) Wilma Wilson écrivait aussi que « la centrale électrique, la buanderie, la boulangerie, le pressing et la ferme fonctionnent grâce au travail des patients. » (p.106) Pourtant, les médecins se gardaient bien de justifier l’existence de thérapies occupationnelles par une gestion quasi autarcique, en autosuffisance, de l’hôpital. Le docteur Stoddard insiste ainsi sur les bienfaits du travail manuel : les patients luttent contre l’ennui et acquièrent des compétences pour subvenir à leurs besoins ultérieurs. (p.43)
L’importance accordée aux thérapies occupationnelles mises en place au sein des hôpitaux psychiatriques californiens renseigne également sur le degré de liberté des femmes californiennes à se définir professionnellement dans les années 1930. Le parcours professionnel de Wilma Wilson ne pouvait que lui être reproché. Elle quitte son emploi de secrétaire médicale pour exercer ses talents de danseuse. (p.64) Doublure d’actrice, elle s’illustre également dans des ballets aquatiques. Financièrement autonome, ses choix professionnels témoignent aussi d’un corps en mouvement. Or, au sein du Camarillo Mental Hospital, Wilma Wilson découvre que le modèle d’épouse au foyer est prôné dans la mesure où il facilite un contrôle des corps féminins.
Un questionnement sur la peur du féminin ?
L’hôpital, pourtant dépeint comme un lieu de villégiature par certains médecins, ne se prête pas au soin des corps. Le désir de soigner son apparence en se coiffant et se maquillant révèlent des tendances érotomanes ou nymphomanes qu’il faut traiter. L’absence d’espaces réservés à la toilette intime limite la propension des femmes à affirmer leur féminité. Wilma regrette ainsi le nombre réduit de miroirs. (p.87) Les chambres de l’hôpital ne possèdent pas de penderies ou de commodes. (p.83)
Un souci de sécurité ne justifie pas de telles mesures. Les miroirs et les rasoirs ne sont pas confisqués aux patients hommes. Selon Wilma, le fonctionnement administratif de l’univers hospitalier asilaire, monde fait pour et par les hommes, traduit, une peur de la féminité. Les femmes ne peuvent avoir accès au reflet de leur propre corps ; celui-ci, objet de délit, doit également être caché aux yeux extérieurs : « Jouxtant notre service, on trouvait une aile réservée aux hommes, une aile dite ‘ouverte’, ce qui signifie que les patients étaient autorisés à se rendre dans le jardin pour fumer ou se promener, un autre exemple du favoritisme. Aucune aile où l’on trouvait des femmes n’était ouverte. Pour les psychiatres, la place de la femme est à la maison, enfermée. » (p.209)
Alors que l’expression de la féminité est condamnée, l’hypersexualisation masculine crée de l’émulation parmi les employés mâles ; ces derniers s’identifient volontiers aux patients alcooliques qui bénéficient régulièrement de passe-droits. (p.89)
Le corps féminin était considéré par beaucoup de médecins comme un terreau favorable au développement de maladies mentales diagnostiquées à travers l’analyse de manifestations physiologiques typiquement féminines telles que les règles. L’attention médicale accordée à l’expression de la coquetterie relevait d’une forme de prévention thérapeutique. Le corps féminin recelait en lui les traces d’une propension à la folie. Dans les années 1930 et 1940, la trace de « catamenial records » dans les archives de différents hôpitaux californiens établissent la corrélation faite par les médecins et le personnel soignant entre les menstrues et l’état mental des patientes. (Braslow, p.157) D’après le récit de Wilma Wilson, l’alcoolisme des femmes était, dans l’esprit des thérapeutes, intimement lié à l’exercice d’une sexualité anormale et dangereuse à laquelle il fallait opposer un modèle de femme au foyer. La vitalité sexuelle observée chez des patients mâles alcooliques n’était, elle, en aucun cas symptomatique d’une maladie mentale.
Les patientes étaient soumises à des injonctions contradictoires. L’internement avait été décrit comme l’occasion rêvée de rencontrer un homme bien né : « ‘Choisis-toi un millionnaire !’ devint un proverbe familier à cause du Docteur Stoddard qui nous avait assuré que l’hôpital regorgeait de gosses de riches venus s’y faire soigner. » (p.218) Mais, l’univers asilaire favorisait une animalisation des comportements : « Elles urinaient et déféquaient sur elles (…) Certaines grimpaient aux arbres (…) avalaient la poussière ou les détritus trouvés sur le sol. » (p.93) Wilma regrettait d’être confrontée à l’image inquiétante de femmes aux corps abîmés par l’expérience de l’internement : « Le bain constituait un moment très déplaisant car les douches grouillaient de corps déformés. » (p.139)
Wilma Wilson fut internée sur décision du juge (et recommandation de sa propre mère !) à la fin des années 1930, après avoir été arrêtée pour conduite en état d’ivresse. Après quatre mois de traitement, elle obtint le droit de quitter le Camarillo Hospital. Son témoignage fut publié en 1940. L’amendement Volstead interdisant la vente d’alcool avait été abrogé en 1933. Comme le prouve son récit autobiographique, Wilma Wilson était davantage l’héritière des suffragettes américaines que des représentantes puritaines des mouvements de tempérance.
They Call Them Camisoles est un récit qui se nourrit de multiples ambiguïtés. Célébration de la femme fatale, il n’en demeure pas moins malgré lui un manifeste sur la condition féminine. Récit d’une survivante de l’expérience de l’internement psychiatrique, il illustre aussi la difficulté de l’auteur à assumer son statut de patiente mentale. Carte de visite d’une starlette plus tout à fait jeune à l’égard des studios, il n’en écorne pas moins la réputation –déjà sulfureuse- de son auteur. La fin tragique de Wilma Wilson, rousse incandescente divorcée en 1941, évoque davantage une pulp fiction qu’une screwball comedy. Son nom apparaît pour la dernière fois dans les colonnes du Los Angeles Times durant le mois de juin 1943 dans la rubrique crimes. Le 5 juin, deux jours après son assassinat, la police découvre son corps nu mutilé sur son lit dans son appartement d’Hermosa Beach, une copie de They Call Them Camisoles à terre. L’enquête conclue qu’après une soirée très arrosée et un bain à bulles, l’ex-actrice de 31 ans a tenté de résister aux avances de Michael Strigano, un militaire âgé de 22 ans. Celui-ci lui aurait administré 25 coups à la tête puis, il aurait tabassé son corps. Ce meurtre sordide est à l’image du clivage symbolisant le comportement de Wilma qui avait choisi l’humour et la comédie pour masquer la réalité blafarde de son existence. Néanmoins, le tour de main de l’auteure est d’avoir écrit un récit traversant les âges et l’imposant comme une sulfureuse femme fatale. Il n’est pas alors étonnant de constater que 70 ans après sa mort, elle est encore citée par Larry Harnisch, spécialiste de l’affaire judiciaire du Dahlia Noir –autre aspirante actrice assassinée- dans les colonnes du Los Angeles Times.
[1] Voir le chapitre consacré à Elizabeth Mae Duncan dans Au-delà du Dahlia Noir, E-Dite, collection Noire, 2011.
Ouvrages cités et lectures conseillées.
Grand Jury Report, County of Ventura, 12 janvier 1977.
Wilson, Wilma. They Call Them Camisoles. Lymanhouse: 1940.
Zaballos, Nausica. Au-delà du Dahlia Noir, E-Dite, collection Noire, octobre 2011.
Zaballos, Nausica. Vie et Mort du Camarillo Hospital. L’Harmattan, 2014.
Abbott, John. “Complete Insanity Hospital.” Berkerley Daily Gazette, 22 mars 1938
Bly, Nellie (1887). Ten Days in a Mad-House. http://digital.library.upenn.edu/women/bly/madhouse/madhouse.html
Russell, Ross. Bird lives! Da Capo Press, 1996, pages 225-226. Première édition : 1973.
Jazz Magazine, “Conversation avec Al Levitt”, mai 1981.
Packard, Elizabeth. The prisoners’ hidden life, or, Insane asylums unveiled: as demonstrated by the report of the Investigating committee of the legislature of Illinois, together with Mrs. Packard’s coadjutors’ testimony. Chicago: 1868.
Braslow, Joel. Mental Ills and Bodily Cures. Psychiatric Treatment in the First Half of the Twentieth Century. University of California Press: 1997, page 26.
Los Angeles Times. “Woman who overindulged tells inside story of ‘cure’.” 16 février 1941.
“Soldier to Face Court-martial in Woman’s Death.” 11 juin 1943.